Un surpoids de responsabilité
L'inflation normative et l'explosion des exigences réglementaires constituent aujourd'hui un défi majeur pour les entreprises. Si l'objectif initial des régulations est d'encadrer les activités économiques pour garantir une meilleure transparence, responsabilité et protection des parties prenantes, la multiplication des normes et en particulier leur interconnexion, conduit à une charge de conformité et de complexité de plus en plus lourde.
POLE CONFORMITÉ
C&R
3/5/20255 min read
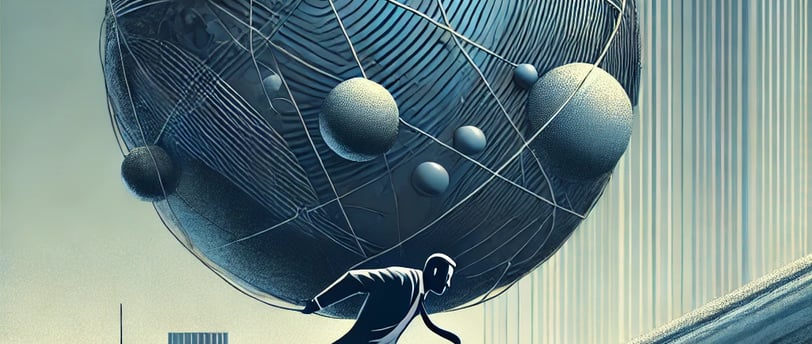

Un surpoids de responsabilité
L'inflation normative et l'explosion des exigences réglementaires constituent aujourd'hui un défi majeur pour les entreprises. Si l'objectif initial des régulations est d'encadrer les activités économiques pour garantir une meilleure transparence, responsabilité et protection des parties prenantes, la multiplication des normes et en particulier leur interconnexion, conduit à une charge de conformité et de complexité de plus en plus lourde.
Un cadre légal de plus en plus oppressant
Avec des règlements comme la CSRD, la NFRD, la taxonomie verte, la directive NIS2, ou encore les exigences du RGPD, sans compter l'arrivée de l'IA, les entreprises se retrouvent à naviguer dans un environnement où chaque action peut potentiellement engager leur responsabilité légale. Cette prolifération de normes, souvent d'origine européenne, complexifie la gestion quotidienne et expose les dirigeants à des sanctions qui peuvent menacer la survie même de leur structure.
L'émergence de l'IA : une nouvelle couche de complexité
L’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les processus d’entreprise ajoute une nouvelle dimension à la conformité. L’IA soulève des enjeux éthiques (respect des droits fondamentaux, non-discrimination), légaux (conformité au RGPD pour la gestion des données) et techniques (cybersécurité et résilience des systèmes).
Les entreprises devront anticiper ces responsabilités supplémentaires en structurant leur gouvernance autour de l’IA, ce qui rajoutera un niveau supplémentaire de complexité et de responsabilité légale.
Une approche préventive et punitive
Bien que les rapports des différentes autorités mettent l'accent sur l'accompagnement et l'éducation à la conformité, les régulateurs communiquent sur les sanctions, amplifiées par la médiatisation des cas de non-conformité. Cette approche crée un climat d'insécurité juridique. La menace constante de sanctions pousse les dirigeants à surinvestir dans des dispositifs de contrôle, au détriment d’une démarche plus proactive d’amélioration continue.
On observe ainsi une forme de "légalisation" des entreprises, où la logique juridique prime sur la logique opérationnelle et stratégique. Cette pression constante fragilise particulièrement les PME et ETI qui ne disposent pas des moyens des grands groupes pour absorber la complexité réglementaire, créant une distorsion de concurrence.
La responsabilité des entreprises : un poids croissant
Ce qui est rarement discuté, c'est l'effet cumulatif de ces normes sur la responsabilité légale des entreprises. Elles deviennent responsables de plus en plus d'aspects de leur activité, y compris des facteurs externes qu'elles ne contrôlent que partiellement (parties prenantes,..) mais aussi internes par manque de compétences ou d'expertise spécifiques (IA, RGPD...) . Cette responsabilisation extrême pèse, car l'erreur ou l'oubli d'une obligation réglementaire devient omniprésente.
Ce climat d'incertitude juridique pousse les entreprises à plaider en faveur d'une simplification des normes et règlements, non pas pour échapper à leurs responsabilités qui au final demeurera, mais pour pouvoir les assumer plus sereinement. Elles réclament une réglementation plus lisible et mieux harmonisée, qui permet de structurer la conformité sans étouffer la dynamique entrepreneuriale. En d’autres termes, la simplification devient une nécessité pour restaurer un équilibre entre contrôle et capacité d’innovation.
Une structure en silo inadaptée à la complexité normative
La plupart des entreprises, hors grand groupes, fonctionnent en silos, avec des départements distincts pour , le business, la finance, les ressources humaines, ou la production. Bien souvent la conformité (AQ, légal, règlementaire) est considérée comme un département support des activités, avec des ressources restreintes. Or avec le développement du RGPD, puis de l'ESG, la digitalisation et l'arrivée de l'IA , on perçoit que les entreprises doivent intégrer ces différentes règlementations et s'adapter structurellement aux nouvelles exigences.
De plus, les nouvelles régulations sont de plus en plus interconnectées : par exemple, la conformité ESG implique des dimensions sociales, environnementales et de gouvernance qui concernent plusieurs services simultanément; l'IA entre éthique, RGPD et cybersécurité... et prochainement ESG puisque l'utilisation de l'IA a aussi un coût carbone.
Cette fragmentation organisationnelle aggrave la charge de conformité, car chaque département traite les exigences de manière isolée, entraînant des doublons, des incohérences, et des coûts humains inutiles. Une approche transversale, où la conformité est intégrée globalement avec des circuits d'information fluides entre les départements, pourrait réduire ces inefficiences tout en renforçant la capacité de l'entreprise à s'adapter aux évolutions normatives.
Conséquences concrètes pour les entrepreneurs
L’accumulation de normes crée un environnement où les entreprises, surtout les PME, peinent à suivre le rythme des évolutions législatives. Cela engendre plusieurs problématiques majeures, dont la nécessité de surveiller, analyser et appliquer une réglementation en constante évolution accaparant des ressources qui pourraient être allouées à la croissance ou à l’innovation. Mais aussi développe une complexité de la prise de décision entre conformité et agilité stratégique.
On assiste aussi à une fragmentation des priorités : Plutôt que d’avoir une vision unifiée de la gestion des risques, chaque nouvelle norme impose des priorités différentes, ce qui disperse les efforts et affaiblit la capacité à construire une stratégie de conformité durable.
On peut tout aussi bien parler de la charge mentale des décideurs du fait de la multiplication des domaines de responsabilité (social, environnement, données, cybersécurité, produits…) créant une pression psychologique accrue sur les entrepreneurs, qui peuvent se sentir dépassés par l'ampleur des risques à gérer et les financements associés.
Une simplification mais pas de dérèglementation
tel était le message répété de la commissaire Européenne Mme Albuquerque et les rapporteurs lors du webcast de la présentation du Pack Omnibus ESG.
Cette réflexion sur l'inflation normative portée au niveau institutionnel, en plaidant pour une simplification des règles et une meilleure coordination des différentes entités réglementaires, peut donner l'impression d'une amélioration. Cependant, même en simplifiant les exigences, en réduisant la voilure des obligations à des catégories ciblées d'entreprises (hors PME), ces nouvelles responsabilités à gérer au quotidien ont un coût soit en ressources, mais aussi en protection juridique et assurantielle.
En outre, la démarche pose aussi la question du rehaussement de la marche entre PME e, ETI et grandes entreprises, en terme de responsabilité et d'obligation. En ciblant les allègements réglementaires sur certaines catégories d'entreprises (souvent les plus petites), l'Europe risque de creuser l'écart entre les PME et les grandes entreprises ou ETI. Une PME qui grandit et passe un seuil critique se retrouverait soudainement confrontée à une marche réglementaire abrupte qui ,en plus des investissements productifs liés à sa croissance, devrait investir dans sa capacité organisationnelle pour encaisser la charge normative et les responsabilités attenantes.
La conformité comme pilier structurel de l'entreprise ?
Face à une régulation en constante évolution, la simplification des normes ne signifie pas l’abandon des responsabilités. Pour les entreprises, cela implique de repenser leur modèle organisationnel en intégrant la conformité comme un élément structurel et non comme une contrainte extérieure.
Cette transformation suppose d’investir dans des expertises transversales : il ne s’agit plus uniquement d’avoir des spécialistes cloisonnés dans un domaine (juridique, RSE, cybersécurité, AQ, IT...), mais des professionnels formés à naviguer dans la complexité des cadres réglementaires interconnectés. La montée en compétence devient donc essentielle : il faut développer des profils hybrides capables de relier les enjeux règlementaires aux impératifs technologiques pour accompagner le développement de l'entreprise.
Conformité et Règlementations
Conseils en conformité pour les entreprises modernes.
Tel : +33 6 82 08 25 91
© 2024. All rights reserved.